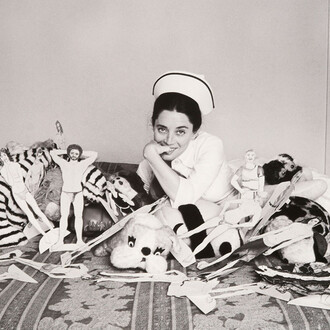Phantasmatic screens explore, à travers la dimension symbolique des paysages, la question de la mémoire liée à l’exil. Dans l’installation The Sojourn (2023), Tiffany Sia part sur les traces du réalisateur King Hu (1931-97), célèbre pour ses films wuxia (films de sabre). Celui-ci fuit la Chine continentale pour Hong Kong en 1949 du fait de la guerre civile – un moment charnière en Chine pendant la période de la guerre froide –, avant de s’installer à Taïwan. Il recrée alors l’atmosphère de son pays natal en filmant, de manière phantasmatique, les montagnes taïwanaises. Sia est frappée par la manière dont il « reconstruit son lieu de naissance, Pékin, qu’il a quitté enfant et où il ne pouvait plus retourner, évoquant un monde ancien dont il a souvenir ».
Le film revisite les lieux de tournage de Dragon inn (1967), guidé par Shih Chun, l’un des acteurs. Aujourd’hui rattrapé par une forme de banalisation – trafic routier, tourisme et urbanisation croissante –, l’endroit est désormais loin des paysages sublimes du cinéma de Hu. Sia examine le rôle des images dans la construction des récits et dans la perception des espaces. Les subtils décalages visuels et sonores reflètent les écarts propres aux souvenirs transformés par l’exil, mais aussi ceux engendrés par la barrière de la langue ou les déplacements culturels. L’artiste omet de sous-titrer certains dialogues et invite ainsi à une écoute active des dialectes, des sons et des intonations, soulignant la nature fragmentaire et élusive de la mémoire. Projeté sur un rideau ondulé, le film devient sculpture. Les conditions de l’expérience cinématographique sont au centre des recherches artistiques et théoriques de Sia, autrice du recueil d’essais On and off-screen imaginaries (2024).
Dans Antipodes III (2024), Sia présente un found footage de vingt-quatre heures correspondant à la diffusion alors en temps réel d’une vue idyllique du site pourtant militarisé de Kinmen, l’île de Taïwan la plus proche de la Chine. Elle appartient à une série d’œuvres qui donnent à voir des plans d’endroits liés aux tensions de la guerre froide dans la région Pacifique ; des territoires hantés, de façon perceptible ou non, par la violence de la militarisation. Ils révèlent comment la mémoire et le paysage se construisent mutuellement à travers les conflits géopolitiques. Par son mode de diffusion, elle fait écho au théoricien de la communication Marshall McLuhan : « Nous regardons le présent à travers un rétroviseur. Nous marchons à reculons vers l’avenir » et s’interroge ainsi sur la manière dont la charge historique de ces lieux façonne le présent de la région du Pacifique.